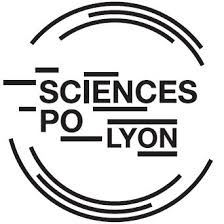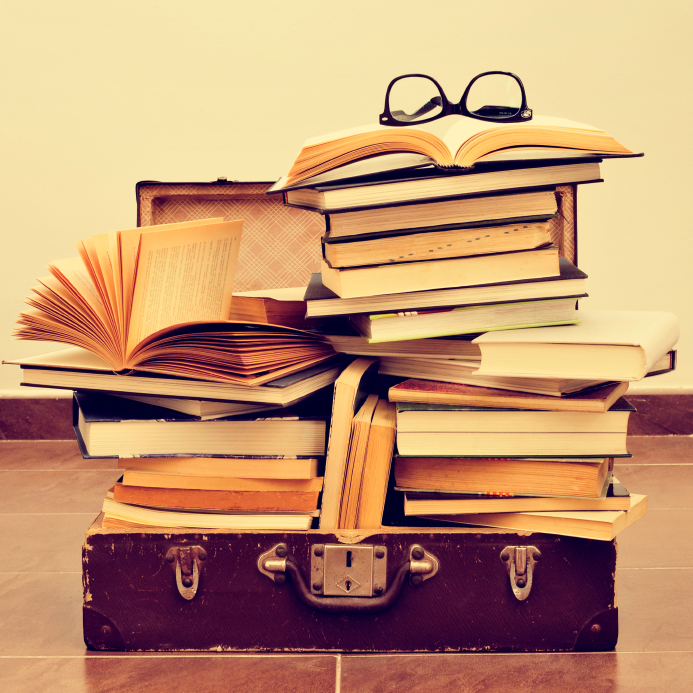Concours commun
Lexique et définitions du Big Data et du numérique
Le thème « Le numérique » du concours commun des Instituts d’Etudes Politiques 2019 va vous amener à vous questionner sur de nombreuses innovations et techniques qui font les gros titres de l’actualité (scandale de Cambridge Analytica par exemple). Parmi celles-ci, je vous propose de passer en revue un certain nombre de Lire la suite…